Le trouble provoqué par une lecture, un mélange de malaise, de fascination et d’euphorie qui oblige à différer le jugement qu’on porte sur ce qu’on lit, voilà ce que j’ai appris à distinguer comme la marque de fabrique des grands textes. C’est ce trouble dont j’ai naguère été saisi à mes lectures de Vies minuscules et de Rimbaud le fils. C’est aussi celui qui m’a accompagné en traduisant Les deux Beune en néerlandais.
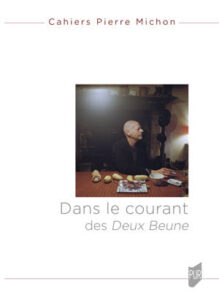 La Grande Beune, la nouvelle qui constitue le première partie du roman, paraît en 1996. Je l’ai traduite en 1997. Pour éviter la diphtongue ‘beun’, qui pour un néerlandais ne fait pas penser au nom d’une rivière mais à un banneton ou à du travail clandestin, j’en ai changé le titre en De hengelaars van Castelnau (‘Les pêcheurs de Castelnau’). Mais voici qu’en 2023 ce paysage de la Dordogne, hanté par la présence de ceux qui ont vécu là depuis 400.000 ans, revit sous la plume de Michon, quand il ajoute une seconde partie intitulée ‘La Petite Beune’, l’ensemble étant publié par les éditions Verdier sous l’appelation ‘roman’. Pour le nouveau titre, Les deux Beune, j’ai bien dû rebrousser chemin: Het stroomdal van de Beune (‘La vallée alluviale de la Beune’) – puisque c’est bien d’une vallée alluviale qu’il s’agit, et puisque cet affluent de la Vézère existe bel et bien; la carte Michelin confirme qu’il y a, près de Les Eyzies, une Grande Beune et une Petite Beune, mais aussi une Beunote et une Beune du Paradoux. On sait qu’en revanche les bourgs et les lieux-dits que Michon situe dans cette vallée sont fictifs. C’est dans ce décor mi-réel, mi-fictif que Michon campe le récit ‘d’une sorte de guet de la femme’, comme il dit dans un entretien de 2002 avec Pierre-Marc de Biasi, l’histoire d’un très jeune homme habité par un désir hors du commun pour une belle dame. Contrairement à l’auteur, qui de son texte de 1996 n’a changé qu’un détail (Jean Lavillatte, rival du narrateur, recevant le patronyme passablement moins viril de Jean Leborgne), j’ai minutieusement revu mon ancienne version, abandonnant là où je pouvais mon penchant pour la préciosité; j’ai aligné entre les deux parties du texte la traduction des mots-clés, images et termes récurrents qui sont comme les piliers sur lequel le texte repose (‘son falbala, sa fibule’ de la première partie revenant par exemple dans ‘les falbalas et les fibules’ de la seconde); j’ai vérifié une nouvelle fois la prédilection de Michon pour l’imaginaire moyenâgeux (notamment dans les métaphores récurrentes de la vassalité et du fabliau) ainsi que pour les mots compère, comparse et acolyte. La traduction paraîtra, deo volente, au printemps de 2024 chez l’éditeur Van Oorschot, à Amsterdam.
La Grande Beune, la nouvelle qui constitue le première partie du roman, paraît en 1996. Je l’ai traduite en 1997. Pour éviter la diphtongue ‘beun’, qui pour un néerlandais ne fait pas penser au nom d’une rivière mais à un banneton ou à du travail clandestin, j’en ai changé le titre en De hengelaars van Castelnau (‘Les pêcheurs de Castelnau’). Mais voici qu’en 2023 ce paysage de la Dordogne, hanté par la présence de ceux qui ont vécu là depuis 400.000 ans, revit sous la plume de Michon, quand il ajoute une seconde partie intitulée ‘La Petite Beune’, l’ensemble étant publié par les éditions Verdier sous l’appelation ‘roman’. Pour le nouveau titre, Les deux Beune, j’ai bien dû rebrousser chemin: Het stroomdal van de Beune (‘La vallée alluviale de la Beune’) – puisque c’est bien d’une vallée alluviale qu’il s’agit, et puisque cet affluent de la Vézère existe bel et bien; la carte Michelin confirme qu’il y a, près de Les Eyzies, une Grande Beune et une Petite Beune, mais aussi une Beunote et une Beune du Paradoux. On sait qu’en revanche les bourgs et les lieux-dits que Michon situe dans cette vallée sont fictifs. C’est dans ce décor mi-réel, mi-fictif que Michon campe le récit ‘d’une sorte de guet de la femme’, comme il dit dans un entretien de 2002 avec Pierre-Marc de Biasi, l’histoire d’un très jeune homme habité par un désir hors du commun pour une belle dame. Contrairement à l’auteur, qui de son texte de 1996 n’a changé qu’un détail (Jean Lavillatte, rival du narrateur, recevant le patronyme passablement moins viril de Jean Leborgne), j’ai minutieusement revu mon ancienne version, abandonnant là où je pouvais mon penchant pour la préciosité; j’ai aligné entre les deux parties du texte la traduction des mots-clés, images et termes récurrents qui sont comme les piliers sur lequel le texte repose (‘son falbala, sa fibule’ de la première partie revenant par exemple dans ‘les falbalas et les fibules’ de la seconde); j’ai vérifié une nouvelle fois la prédilection de Michon pour l’imaginaire moyenâgeux (notamment dans les métaphores récurrentes de la vassalité et du fabliau) ainsi que pour les mots compère, comparse et acolyte. La traduction paraîtra, deo volente, au printemps de 2024 chez l’éditeur Van Oorschot, à Amsterdam.
Mais il y a eu pour moi une autre intertextualité à l’oeuvre dans ce travail. Les textes de Michon m’ayant accompagné durant pratiquement toute ma vie de traducteur (Michon est plus intensément traduit en néerlandais qu’en toute autre langue, soit dit en passant), j’en ai incorporé à ma propre substance des motifs, des fragments, des phrases, des tournures et des mots. Traduire Les deux Beune a parfois pris la forme de retrouvailles: au-delà d’un style que je reconnais entre mille, des échos de textes antérieurement traduits me sont revenus à la mémoire. Les jupes levées d’Yvonne me rappellent celles qui sont levées dans le texte sur Goya (dans Maîtres et serviteurs), comme le cri répété d’Yvonne me fait penser aux cris de la ‘créature superlative, (…) la Lilith indifférenciée, (…) poussant une sorte de chant outré’ dans celui sur Watteau. Quand par l’alternance des temps verbaux l’insistance du regard d’Yvonne est suggérée (‘Elle me regarda. Elle me regardait. Elle ne regarda plus que moi’), je revois une autre scène où un regard se fait insistant, dans le texte sur Piero della Francesca (également dans Maîtres et serviteurs): un paysan frappe chez le pauvre Lorentino, lui commande un portrait de Saint Martin et n’a pour s’en acquitter qu’un porc de dix livres (‘Lorentino regardait le cochon. Pendant que l’autre parla, il regarda le cochon’). Le narrateur ‘perdu comme un ogre déguisé en Petit Poucet’, dans Les deux Beune, renvoie pour moi au narrateur ‘Petit Poucet imbu et lettré’ ayant ‘en chemin semé le Gilles de Rais’, dans la ‘Vie du père Foucault’. Et même un adverbe peut me sauter à la figure: quand ‘[les enfants] couraient dare-dare rejoindre les ancêtres avec leurs paniers d’oeufs pour le voyage’, j’entends aussi ‘Javier qui n’allait pas rejoindre dare-dare dans la fosse ses petits frères et soeurs arrêtés sous leur forme parfaite’, encore dans le Goya, ou ‘dare-dare en deçà de Suez les docteurs Nicolas et Pluyette qui officiaient avec une scie dans l’hôpital de Marseille’, dans Rimbaud le fils.
Parfois le sentiment de familiarité ne provenait pas d’une occurrence répétée mais d’une particularité stylistique. Je pense aux effets de rime que Michon sème nonchalamment dans sa prose, pierre d’achoppement pour le traducteur et pour cette raison-même s’imposant à lui avec une acuité particulière. Je relève, dans Les deux Beune: ‘Puis aussitôt, comme si toute la cambrure depuis les talons hauts portait à la bouche ce défi, ce déni: « Non. Non, sûrement je n’y serai pas.»’ ou encore, quelques lignes plus loin: ‘Elle lâcha le flipper, elle tourna les talons et vivement amena dans le brouillard ses façons de glamour, ses aplombs de grue, son fourreau de nuit sous quoi régnait, absconse, absolue, la fente considérable.’ Remarquons ici la polysémie de l’adjectif ‘considérable’, qui ajoute au vertige que cette fin de chapitre ne peut manquer de produire. Mais pour m’en tenir aux effets de rime, je cite, dans Maîtres et serviteurs, les narratrices affirmant que «[Goya] nous peignait, sans histoire nous atteignait, sous la table ou par-dessus», ou le curé de Nogent ignorant par quoi [Watteau] «les séduisait, les réduisait peut-être ou les suffoquait». Dans de tels cas, il n’y a pas d’autre issue pour le traducteur que de chercher, dans sa langue, des bonheurs de langage similaires, s’il en trouve, pour les insérer là ou ailleurs dans sa version du texte original.
Forcément, la multiplication des métaphores et des sous-entendus érotiques constitue un problème majeur dans la traduction de Les deux Beune. Le narrateur a des imaginations qui suivent ‘le noeud exaspéré’ de la terre; il ‘enfile le pont’ pour se retrouver ‘sur l’autre lèvre’; il s’assied sur ‘la grosse bille du milieu’… Même si Les deux Beune ajoute au désir empêché de la première partie une promesse d’assouvissement dans la seconde, ce qui fait avancer le texte n’est pas, à mon sens, cette issue romanesque, très relative et qui n’est d’ailleurs guère étoffée. L’ensemble est encore et toujours un fantasme, une jouissance différée, il reste ‘une sorte de guet de la femme’; les scènes où le corps convoité est décrit, détaillé, décortiqué, se suivent inépuisablement et jusqu’à la férocité; dans la seconde partie aussi, le coeur du texte consiste en l’apparition de la chair et l’exaltation de ce qui la recouvre. C’est dans le paradoxe de la visibilité de ce qui est interdit que le lyrisme de Michon atteint son apogée et que sa langue s’emballe. Quand je l’ai interrogé sur le sens de cette phrase sybilline: ‘C’est par la langue qu’on prend les poissons et les hommes’, Michon dans sa réponse lie explicitement langue et désir: « Homo ne bande pas sans les mots, sans se dire qu’il bande. Et c’est bien Vir. Mais ça pourrait être aussi bien la femme. Elle aussi on la prend par la langue, avec toutes les variantes. »
Si traduire Les deux Beune a été pour moi une expérience jouissive, c’est aussi grâce à la sollicitude de l’auteur, qui a eu à coeur d’élucider son texte crypté à souhait et de rassurer le traducteur-acolyte s’acharnant à recréer ce tissu de langue et de désir. Questionnant l’iconoclasme des deux ‘petits paysans bravaches’, Jean et Jeanjean, qui ‘virèrent tout’ ce qu’il y avait de peint dans la grotte préhistorique de Chez-Quéret, ou non – mais enfin, Pierre, qu’est-ce qui en est de ces on-dits? Michon répond: « Cet épisode est fait pour que les lecteurs se posent justement les questions que tu te poses. Garde le flou artistique. » De même, quand la 203 de Jeanjean passa ‘dans les vingt mètres d’ouverture sur la piste forestière’, ces ‘vingt mètres d’ouverture’ font penser au ‘vingt mètres de monde’ visibles dans le brouillard, mais puisqu’à ce moment il n’y avait ‘plus de brouillard’, comment se figurer cette ouverture – simplement comme le champ de vision du narrateur? Michon, derechef: « Oui. Ou comme une intervention d’Aphrodite. » Le sens de la phrase ‘Ses ongles de sang frais jouèrent’, qui décrit le moment suprême où le narrateur et son complice dans le crime sont sur le point de passer à l’acte, suscite chez le traducteur une question bête: ‘Est-ce ici une référence au sang frais de l’érection, ou le geste du scandaleux dégainage s’accompagne-t-il d’un saignement?’ et chez l’auteur la simple réponse: « Mais non, c’est seulement son vernis à ongles rouge vif ! » Quand il faut conclure, il n’y a plus de place pour le flou artistique.
- Références* ‘Pierre Michon, un auteur majuscule’, propos recueillis par Thierry Bayle, Le Magazine littéraire, no 353, avril 1997.
* ‘Les Carnets inédits de La Grande Beune’: propos receuillis par Pierre-Marc de Biasi, Genesis, no 18, Éditions Jean-Michel Place, 2002.
* Jill Alessandra McCoy, ‘Michon et ses traducteurs’, Cahier de l’Herne no 120: Pierre Michon, Supplément, p.341-345. Cf aussi: https://www.lesamisdepierremichon.fr/traductions.html
Resumé
Bref-compte rendu de l’expérience de traduire de Les deux Beune de Pierre Michon en néerlandais, traduction qui paraîtra sous le titre Het stroomdal van de Beune chez les éditions Van Oorschot, à Amsterdam, en 2024. On signale l’intertextualité spécifique produite par la familiarité du traducteur avec les textes de Pierre Michon: certains motifs, alternances de temps verbaux, effets de rime fonctionnant comme des échos de textes antérieurs. En on explique pourquoi la sollicitude de l’auteur rend l’acte de traduire jouissif.
Summary
A short account of the experience of translating Les deux Beune by Pierre Michon in Dutch, a translation due to be published in 2024 as Het stroomdal van de Beune by Van Oorschot publications in Amsterdam. Pointed out is the specific intertextuality produced by the familiarity of the translator with Michons works: certain motives, as the alternation of verbal tenses or the effects of rhyme, function as resonances of earlier texts. The benevolence of the author is invoked as condition of the particular jouissance that accompanies the translating act.
- Rokus Hofstede, in: Cahiers Pierre Michon no.2, ‘Dans le courant des Deux Beune’, red. Agnès Castiglione & Denis Labouret, PUR éditions, 2024

